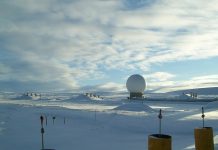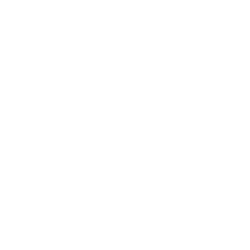“Nous sommes passés d’un monde de marchés à un monde de surveillance.’ Dans cet écosystème, nos choix deviennent des données, et le technoautoritarisme façonne silencieusement nos vies.” Shoshana Zuboff.
“La capacité de collecter et d’analyser des données personnelles pourrait permettre à une seule entité de contrôler la société entière. Le technofascisme n’est plus de la science-fiction, il se tisse dans nos algorithmes.” Yuval Noah Harari.
Dans leur livre « Apocalypse Nerds, comment les technofascistes ont pris le pouvoir», les auteurs Nastasia Hadjadji et Olivier Pesquet s’interrogent sur la dérive supposée à l’œuvre sur la recomposition du pouvoir par la technique, une sorte de contre-révolution antidémocratique et ultralibérale. La description se rapproche du désormais célèbre « Ingénieurs du chaos » (JC Lattès 2019) de Giuliano da Empoli. Quelles sont les motivations profondes de l’élite technologique et la fascination qu’elle exerce ? Est-ce que la tech peut conduire au fascisme ou, plus simplement, à l’autoritarisme ?
En paraphrasant Albert Camus, il est important de « bien nommer les choses » car les opinions, les réactions et les conséquences peuvent être différentes.
Comment est-on passé d’un « libertarianisme gentiment hostile à l’Etat » à des saluts fascistes (Elon Musk 20 Janvier 2025) ? Quelles sont donc les différences entre « technoautoritarisme » et «technofascisme » ?
Technoautoritarisme.
L’autoritarisme est un régime politique où le pouvoir est concentré entre les mains d’un individu ou d’un groupe, avec peu ou pas de libertés politiques, de contre-pouvoirs ou de transparence. Ce pouvoir autoritaire va utiliser la technique comme moyens de coercition, de surveillance et de sanctions. L’archétype du technoautoritarisme est la Chine où la reconnaissance faciale et le big data permettent de suivre les déplacements et comportements des citoyens et où, au travers du système de crédit social (social credit), les données sont utilisées pour récompenser ou punir certains comportements anti-sociaux ou anti-chinois. Le gouvernement chinois va également utiliser la censure numérique en bloquant ou filtrant des sites, manipulant des algorithmes ou en imposant des plateformes nationales, comme le grand Firewall. D’une manière générale, le technoautoritarisme est aussi utilisé pour influencer l’opinion publique, affaiblir la confiance dans les institutions ou légitimer un pouvoir autoritaire (comme en Russie par exemple). Le but est d’assurer la stabilité politique et de prévenir la contestation, en utilisant la technologie comme instrument d’efficacité du contrôle. Le technoautoritarisme apparaît dans des univers où la technologie est un outil de surveillance, de gestion et de contrôle social, sans forcément une grande idéologie totalitaire. S’il n’y a pas, stricto sensu, de bases idéologiques, il y a néanmoins quelques principes clés qui constituent le socle du technoautoritarisme : rationalisation du pouvoir, surveillance comme garantie d’ordre, promesse d’efficacité technologique, effacement de la vie privée, ingénierie sociale algorithmique. D’autre part, il n’y a pas vraiment de penseurs « officiels » se réclamant ouvertement du technoautoritarisme, mais quelques philosophes, politologues et théoriciens qui ont analysé, critiqué ou anticipé ses fondements intellectuels, ses formes et ses dérives. Parmi les précurseurs, et si on remonte loin, on trouve Jeremy Bentham (1748–1832) (le panoptique), Max Weber (1864–1920) (domination bureaucratique) et, plus près de nous, Jacques Ellul (1912–1994). Si on regarde les théoriciens du contrôle et de la surveillance, on peut citer Gilles Deleuze (1925–1995) et Shoshana Zuboff (née en 1951) avec son concept de « capitalisme de surveillance »*. Enfin, parmi les chercheurs en politique ou en géopolitique qui étudient le technoautoritarisme comme système politique contemporain, on trouve principalement Yuval Noah Harari (né en 1976), Evgeny Morozov (né en 1984), Kai-Fu Lee (né en 1963) et les penseurs chinois du “smart authoritarianism”, ainsi que Byung-Chul Han (né en 1959) qui parle de « servitude volontaire numérique ». Le concept de technoautoritarisme fait son apparition dans les œuvres cinématographiques de fiction comme Black Mirror (Charlie Brooker) ou plusieurs épisodes (“Nosedive”, “Arkangel”, “Shut Up and Dance”) montrent une société régie par la notation, la surveillance ou les algorithmes. Le pouvoir ne vient alors pas d’un dictateur, mais d’un système technique intégré que tout le monde accepte. C’est du technoautoritarisme diffus : chacun devient le surveillant de l’autre. L’autre exemple qu’on peut citer est Minority report (2002), le film de Steven Spielberg d’après Philip K.Dick** où on retrouve la logique du pouvoir préventif typique du technoautoritarisme. Dans le technoautoritarisme, la technique est un moyen, pas une fin. Le pouvoir politique (souvent bureaucratique ou pragmatique) se sert de la technologie pour optimiser la gestion des corps et des comportements. Le citoyen devient un « objet d’administration ».
Technofascisme.
Le mot fascisme évoque spontanément la brutalité des régimes totalitaires du XXᵉ siècle — la terreur visible, les masses en uniforme, la domination et le culte du chef. Mais dans le monde hyperconnecté du XXIᵉ siècle, dans lequel nous vivons, le fascisme a changé de forme. Il n’a plus besoin de bottes ni de censure explicite : il se déploie sous la forme d’algorithmes, de protocoles, de plateformes. Le technofascisme n’est pas vraiment un régime politique identifiable, mais une structure de pouvoir immanente, née de la fusion entre l’autoritarisme, la rationalité technicienne, le désir de contrôle et l’économie numérique. Il ne s’impose plus par la violence physique, mais par la logique du calcul et la promesse du confort social et intellectuel. Sous l’apparence d’un progrès neutre et rationnel, il réalise l’un des rêves les plus anciens de la domination : celui d’un monde sans incertitude, sans désordre, sans altérité. Pour en comprendre les origines, il faut remonter à la raison technicienne montrée et démontrée par Jacques Ellul, ainsi que Herbert Marcuse (1898-1979) et Günther Anders (1902-1992), c’est-à-dire quand la domination se déguise en progrès. Le technofascisme veut éliminer le désordre et la différence en dépouillant cette logique de tout contenu politique explicite. La société algorithmique ne dit pas : « obéis au chef », elle dit : « conforme-toi aux données ». Le technofascisme ne tue pas la démocratie : il la neutralise. Les élections, les débats publics et les médias existent toujours, mais ils sont immergés dans un espace numérique dominé par des logiques marchandes et comportementales. Le citoyen devient consommateur d’opinions, prisonnier d’algorithmes qui renforcent ses croyances plutôt qu’ils ne l’invitent à penser. Le but n’est pas seulement de contrôler mais de façonner une société “idéale” selon une vision totalitaire.
Le terme « technofascisme » n’ayant pas (encore) une définition académique unifiée, il est difficile de trouver des figures intellectuelles strictement dédiées au concept. Néanmoins, on peut citer Nick Land (né en 1962), associé au courant de l’accélérationnisme, Jacques Ellul (déjà cité) et, surtout, certains penseurs américains que nous allons retrouver par la suite. C’est dans la littérature qu’on va retrouver des œuvres proches du technofascisme, très souvent sous la forme de dystopie. Par exemple les célébrissimes 1984 de Georges Orwell (1903-1950) et Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley (1894-1963), mais aussi Nous autres d’Yevgeny Zamiatin(1884-1937), The city of light de Mieczysław Smolarski(1888-1967) et, plus près de nous, The electric state de Simon Stålenhag (né en 1984). Dans cette fusion entre l’homme et la machine, les œuvres de fiction cinématographique ont, bien sûr, leur importance. Blade Runner (1982) de Ridley Scott, d’après Philip K.Dick, où on parle de technofascisme corporatif. On peut citer également Bienvenue à Gattaca (1997), film d’Andrew Niccol qui définit une société eugéniste où la technologie définit la valeur humaine, et où l’imperfection est éliminée (lié au concept de transhumanisme). Un autre exemple est celui du film Equilibrium (2002) de Kurt Wimmer où le pouvoir technologique s’allie à un culte de l’ordre et de la pureté émotionnelle pour éviter la guerre.
Le « cas » des Etats-Unis.
Le « cas » américain conjugue une tradition libérale individualiste avec une idéologie techniciste profondément enracinée. La culture américaine a toujours entretenu un rapport quasi religieux à la technologie. Depuis la conquête de l’Ouest jusqu’à la conquête spatiale, les États-Unis se sont construits sur l’idée que l’innovation technique équivaut au progrès moral. La machine, le moteur, l’ordinateur et l’intelligence artificielle sont devenus les emblèmes de la destinée manifeste (manifest destiny) américaine, la croyance que la technologie est la clé de la liberté, du pouvoir et de la supériorité. Mais cette foi technologique a un revers : lorsqu’elle se combine au culte de la puissance et à l’obsession de l’ordre, elle peut engendrer une forme de « fascisme soft », une idéologie de la domination par la machine et, de facto, de la soumission consentie à l’efficacité. On peut alors parler de technofascisme culturel c’est-à-dire un environnement où la liberté devient un produit dérivé de la performance. La Silicon Valley représente la forme contemporaine de ce mythe et ses personnages emblématiques (Steve Jobs, Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg….) s’identifient à des visionnaires capables d’améliorer et sauver le monde grâce à la technologie. Cette culture se base sur un utopisme libertaire (refus de l’État, valorisation de l’individu), un culte de la performance et de la disruption (détruire pour innover sur un modèle schumpeterien) et une dimension quasi « messianique » dans le sens de la mission civilisatrice initiée par les pères pélerins. Mais, la logique de contrôle ne libère pas les individus, elle les gouverne par la donnée et la dépendance. C’est le paradoxe américain soit une culture basée sur la liberté comme dogme, mais qui engendre des technologies de surveillance et de domination. Aux États-Unis, la puissance du numérique repose sur une alliance implicite entre l’État et les grandes entreprises technologiques. Les plateformes privées gèrent les infrastructures vitales (clouds, câbles, data centers) dont dépendent aussi bien les services publics que la défense nationale. Il y a un mélange des genres qui crée une oligarchie technopolitique, et le pouvoir n’est plus vraiment démocratiquement réparti mais concentré entre quelques acteurs capables de façonner la réalité numérique, c’est-à-dire définir ce qui est visible, dicible et mesurable. L’enjeu n’est plus seulement de convaincre, mais de conditionner les comportements en manipulant, entre autres, les électorats (voir le scandale Cambridge Analytica de 2016).
Conclusion
Ces 2 mots sont aujourd’hui régulièrement énoncés, répétés, étudiés, discutés parce qu’ils condensent en deux concepts la peur contemporaine c’est à dire la concentration du pouvoir technologique et le risque qu’il soit utilisé pour contrôler, manipuler ou limiter les libertés individuelles. Ils résonnent avec nos expériences quotidiennes (réseaux sociaux, surveillance de l’internet, algorithmes) et les débats politiques sur l’avenir de la démocratie. Il faut distinguer les 2 principes car ils sont différents : technoautoritarisme qui est l’usage autoritaire des technologies et technofascisme qui représente la fusion idéologique entre fascisme et technologie. Il faut également être prudent en employant le terme “fascisme” car cela risque de diluer le concept, en confondant un autoritarisme algorithmique avec les totalitarismes du XXᵉ siècle. Mais c’est aussi un signal d’alarme politique soit une manière de rappeler que le contrôle social peut renaître sous des formes nouvelles et plus subtiles. Et il ne faut pas oublier que ces 2 concepts ne se contentent pas de contrôler ou de dominer : ils se mettent en scène, il y a une esthétique du pouvoir, l’un par la transparence et la pseudo neutralité (technoautoritarisme), l’autre par la grandeur, la domination et la pureté technique (technofascisme). L’interface devient le nouveau visage du pouvoir : le monde doit être aussi clair, fluide et contrôlable qu’un écran Apple. C’est cette esthétique qui peut paraitre inquiétante car cela peut mener à la fascination et le phénomène s’est déjà produit dans le passé. Bis repetita…. ?
Encadrés.
*Shoshana Zuboff « L’age du capitalisme de surveillance » (2022).
Le capitalisme de surveillance désigne un modèle économique dans lequel les entreprises collectent, analysent et exploitent les données personnelles des individus pour prédire et influencer leur comportement, afin de générer du profit. Contrairement au capitalisme traditionnel, la valeur principale provient moins de la production de biens ou services que de la monétisation des comportements humains. Les principes clés en sont : la collecte massive de données, la prédiction et la manipulation des comportements, l’exploitation des données sans consentement, l’asymétrie de pouvoir. Ces principes sont aujourd’hui inclus et assumés par toutes les plateformes numériques et les grands groupes.
**Philip K. Dick (1928-1982).
Les notions de technoautoritarisme et de technofascisme sont très présentes dans l’œuvre de Philip K. Dick, souvent de manière prémonitoire.
Selon lui, les machines et les réseaux deviennent les relais d’un pouvoir omniscient où le citoyen perd son autonomie et son indépendance au profit d’un système algorithmique ou bureaucratique inhumain.
Exemple : « Minority Report » (1956) : la société prédit et punit les crimes avant qu’ils soient commis – anticipation du predictive policing et de la surveillance algorithmique moderne.
Le technoautoritarisme selon Dick est souvent désincarné : ce n’est plus un tyran, mais le système technologique lui-même qui devient oppresseur
D’après Dick, le technofascisme va plus loin : il combine la logique autoritaire à une idéologie de la perfection technologique, de l’ordre absolu et de la purification de la société par la machine. La technologie devient un instrument de sélection, d’épuration ou de domination morale. Exemple : « The Man in the High Castle » (1962) : l’idéologie fasciste est étroitement liée à une maîtrise technologique (armes, médias, propagande) – la domination repose sur une technostructure totalitaire. Les œuvres de Dick sont très actuelles car elles font état des concepts tels que :
La surveillance algorithmique (reconnaissance faciale, IA prédictive).
Les bulles de réalité (réseaux sociaux, désinformation).
Les idéologies transhumanistes, parfois teintées de désir de purification ou de dépassement de l’humain (concept repris, entre autres, par Peter Thiel, un proche de J.D Vance, vice-président des Etats-Unis).
Pour aller plus loin.
La littérature sur ces 2 sujets est abondante. Il s’agit donc ici d’une sélection subjective !!
Les basiques :
Orwell G. « 1984 » Ed. Folio 2020.
Huxley A. « Le meilleur des mondes » Ed. Pocket 2017.
Les chercheurs.
Ellul J. « Le système technicien » Ed. Cherche-Midi 2012.
Harari Y.N « Homo Deus. Une brève histoire de l’Avenir » Ed. Albin Michel 2022.
Morozov E. « Le mirage numérique. Pour une politique du Big Data »
Ed. Prairies ordinaires 2015.
Les « modernes ».
Zamiatine E. « Nous autres » Ed. Babel 2015.
Zuboff S ; « L’âge du capitalisme de surveillance » ED. Zulma 2022.
Hadjajji N. et Tesquet O. « Apocalypse nerds. Comment les technofascistes ont pris le pouvoir » Ed. Divergences 2025.
Mhalla A. Cyberpunk. Le nouveau système totalitaire » Ed. Seuil 2025.
Bogé A. « La silicon valley prend le pouvoir ». revue Conflits Décembre 2