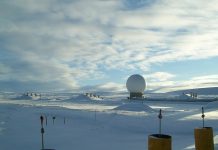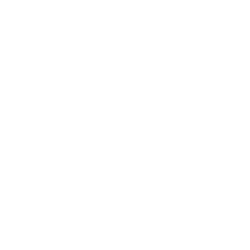L’Italie fasciste (1922–1945) constitue l’un des premiers laboratoires politiques du XXᵉ siècle où la culture fut mobilisée de manière systématique comme instrument de gouvernement.
Bien au-delà de la simple diffusion d’un discours idéologique, le régime de Mussolini a cherché à façonner les sensibilités, les perceptions et les comportements, en transformant l’art et les productions culturelles en un dispositif central de légitimation politique. Architecture monumentaliste, cinéma de masse, iconographie héroïsante, fêtes populaires et rituels collectifs : tous ces éléments concouraient à construire un environnement symbolique cohérent, destiné à insérer le citoyen dans une vision totalisante du monde social et politique. Le fascisme ne considérait pas la culture comme un domaine autonome, mais comme un vecteur privilégié de transformation anthropologique, au service du projet de création d’un “nouvel Italien” discipliné, viril et entièrement dévoué à la nation.
Cet intérêt pour la culture comme outil d’ingénierie sociale s’inscrit dans un contexte intellectuel où les régimes autoritaires du début du XXᵉ siècle, en Europe et au-delà, ont progressivement reconnu l’importance des médias de masse, de l’esthétique politique et de la scénographie collective pour produire du consentement. Les recherches contemporaines en sociologie politique et en études visuelles ont montré que la domination ne s’exerce pas uniquement par la contrainte ou l’endoctrinement explicite, mais aussi par la construction d’un imaginaire partagé, par l’activation d’émotions collectives et par l’imprégnation au quotidien de l’idéologie. Dans le cas italien, la mise en place d’un appareil culturel structuré, du Ministère de la culture populaire (Minculpop) aux studios de Cinecittà, révèle la volonté d’investir tous les registres de la vie sociale : loisirs, éducation, spectacles, urbanisme, sport, presse illustrée, iconographie du chef. La culture fasciste n’est pas un simple décor du pouvoir, mais une technologie politique à part entière.
Comment le régime fasciste a-t-il converti l’art et la culture en un instrument de pouvoir destiné à structurer les imaginaires collectifs, gouverner les comportements et fabriquer du consentement ?
La puissance symbolique de la culture
Mussolini a rapidement compris que le contrôle politique seul ne suffisait pas. Pour imposer durablement son autorité, il fallait agir sur les esprits et les émotions du peuple et l’art et la culture sont des outils directs pour façonner l’imaginaire collectif et le roman national. Le régime va produire, commander et mettre en scène des œuvres, dans le domaine culturel, pour transmettre des valeurs fascistes. L’Italie fasciste va donc expérimenter une combinaison : discipline politique + manipulation culturelle, ce qui va en faire un laboratoire de propagande et de manipulation des foules. Le fascisme ne considère pas l’art comme autonome : il doit être au service du politique. Tous les domaines artistiques sont orientés pour glorifier l’État et le Duce, créer un sentiment d’unité nationale, modeler l’homme nouveau fasciste (jeune, fort, discipliné), légitimer l’impérialisme et la conquête. Cette propagande va être omniprésente dans tous les domaines artistiques et va mobiliser architecture, cinéma, musique, théâtre, ballet, arts visuels, littérature et fêtes publiques.
Nous allons prendre 4 exemples significatifs de cette stratégie : la littérature, le cinéma, le théâtre et la musique.
Littérature comme vecteur d’influence.
Mussolini ne crée pas une culture nouvelle : il réorganise le patrimoine existant pour le mettre au service du pouvoir. Le contrôle culturel va être institutionnalisé et dès les années 1920, l’État fasciste crée des structures dédiées à la supervision de la production intellectuelle : le Ministero della Cultura Popolare (MinCulPop), des commissions de censure et des organismes professionnels obligatoires pour les écrivains. Ce dispositif permet au régime de filtrer en amont les contenus publiés, instaurant une autocensure durable parmi les auteurs. La domination culturelle devient ainsi un prolongement de la domination politique. Le régime transforme les écrivains en sources de légitimité, relais idéologiques et outils symboliques.
Les auteurs classiques vont être réappropriés par le régime à des fins idéologiques et relus à travers un prisme nationaliste et autoritaire. Leurs œuvres sont intégrées aux programmes scolaires et commentées de manière orientée. On peut citer :
Dante Alighieri (1265–1321) présenté comme le « père de la nation » et utilisé pour promouvoir l’unité, l’identité italienne et le patriotisme.
Nicolas Machiavel (1469–1527) réinterprété en théoricien du pouvoir autoritaire et utilisé pour justifier la violence politique et le culte du chef.
Ugo Foscolo (1778-1827) et Giosuè Carducci (1835-1907), poètes patriotiques
récupérés pour glorifier le culte de la nation et du sacrifice.
Ensuite, des intellectuels contemporains vont se rallier au fascisme le plus souvent par cooptation.
Giovanni Gentile (1875–1944) qui est le principal idéologue du fascisme, auteur de la doctrine, Ministre de l’éducation, qui va justifier intellectuellement l’État total, la subordination de l’individu audit état et, bien sûr, l’autorité du Duce.
Gabriele D’Annunzio (1863–1938) voir encadré.
Curzio Malaparte (1898-1957) qui sera un écrivain fasciste dans les années 1920 et s’en éloignera ensuite.
Certains écrivains ne peuvent pas s’exprimer librement comme Alberto Moravia (1907-1990)) et Elio Vittorini (1908-1966) ainsi que les auteurs juifs après 1938 qui seront exclus de la vie artistique. Des revues, comme Critica Fascista ou Primato, regroupent des écrivains « officiels » du régime.
Le cinéma, un outil privilégié par le régime fasciste.
Mussolini considérait le cinéma comme « l’arma la piu forte » pour influencer l’opinion publique. Le régime comprend très tôt que l’image animée peut toucher un public vaste, y compris les classes populaires ou analphabètes. Les objectifs principaux du cinéma vont être de diffuser les valeurs fascistes, glorifier Mussolini et l’État, promouvoir l’impérialisme italien, contrôler l’information et modeler les comportements de la jeunesse, de la famille et du milieu du travail. Dans un premier temps, il faut éduquer les masses, car l’Italie est devenue fasciste et la population l’a accepté tacitement. La création de l’institut Luce (L’Unione per la cinematografia educativa) par Mussolini en 1924 est destinée à la production des Actualités (Cinegiornali) avec pour but de diffuser dans les actualités cinématographiques l’image et l’oeuvre de Mussolini dans toute l’Italie. Parmi les 772 films produits en Italie entre 1930 et 1943, on peut classer comme films de propagande directe ou indirecte environ une centaine. Les films de propagande proprement dits exaltent les racines romaines, le fascisme, le colonialisme (au moment de l’invasion de l’Éthiopie) le militarisme, l’impérialisme, l’anticommunisme et le culte du chef.
Le premier film de propagande fasciste, qui remonte à 1923, est Il grido dell’aquila de Mario Volpe (1894-1968). Le Duce contrôle toutes les images produites par le Luce. C’est en septembre 1934, grâce principalement à Luigi Freddi (1895-1977), chef de la Direction générale de la cinématographie, que se met en place en Italie une structure cinématographique qui se veut capable de concurrencer l’industrie hollywoodienne. Si le cinéma long-métrage de fiction n’a pas vraiment vocation à faire de la propagande, il doit néanmoins rappeler l’origine glorieuse de l’Italie fasciste à travers des films à grand spectacle (une spécialité italienne) comme Scipione l’Africano (1937) de Carmine Gallone, film de propagande coloniale, financé par le régime et parallélisme évident entre Rome antique et fascisme ; Condottieri(1937) de Luis Trenker (1892-1990), ainsi que Camicia nera (1933) de Giovacchino Forzano (1883-1970) qui pose le mythe de la Marche sur Rome. On peut citer également Vecchia Guardia (1934) d’Alessandro Blasetti (1900–1987), film explicitement fasciste, glorifiant les chemises noires ; Luciano Serra, pilota (1938) de Goffredo Alessandrini (1904–1978), avec la participation de Mussolini lui-même qui glorifie l’héroïsme aérien, le patriotisme et la virilité ; Lo squadrone bianco (1936) de Augusto Genina (1892–1957) sur la propagande coloniale en Libye. Et il ne faut pas oublier Roberto Rossellini (1906–1977) qui, avant d’être un maître du néo-réalisme italien a réalisé une « trilogie de la guerre fasciste » centrée sur l’armée : La nave bianca (1941), Un pilota ritorna (1942) et L’uomo della croce (1943). L’industrie cinématographique fasciste se dotera de lieux permettant la réalisation et le développement de films comme les studios Cinecittà, fondés à Rome en 1937 par Luigi Freddi. Enfin, un autre moteur du développement du cinéma fasciste est l’inauguration, en 1932, de la Mostra de Venise (Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia) qui est le plus ancien festival de cinéma au monde et qui existe encore aujourd’hui !
Le théâtre, un soutien ambigu.
Dès son arrivée au pouvoir, Mussolini met sous tutelle le monde théâtral et met en place une censure stricte, des subventions contrôlées et des institutions officielles comme en 1930, la Direction générale du théâtre, sous l’égide du MinCulPop, créée en 1930 et chargée de surveiller les œuvres et les artistes car tout spectacle doit être conforme à l’idéologie fasciste et comme moyen de diffusion de l’idéologie mettant en avant le nationalisme, la discipline, l’obéissance, la virilité, le militarisme et la glorification de la Rome antique (faire croire que le fascisme est l’héritier naturel de Rome). Le régime va combattre toute forme de théâtre jugée dangereuse en censurant les œuvres antifascistes, le théâtre dit « engagé », les pièces trop réalistes ou pessimistes ainsi que les auteurs étrangers trop critiques. La liberté artistique est fortement limitée. Le fascisme ne veut pas seulement convaincre les élites, mais aussi le peuple donc instaurer un « théâtre de masse ». Le régime va développer des spectacles en plein air, des festivals, des représentations bon marché, des tournées dans les provinces. Avec l’Opera Nazionale Dopolavoro, les ouvriers sont encouragés à assister à des spectacles fascisants et le théâtre devient un outil d’endoctrinement collectif. Le but est de susciter l’admiration, jouer sur les émotions et promulguer un sentiment d’unité nationale. Néanmoins, il y aura une forme de résistance avec l’allégorie, l’ironie et le double sens, certains auteurs et artistes sachant préserver des espaces de liberté. Parmi les principaux auteurs de théâtre de cette période, on peut citer :
Luigi Pirandello (1867-1936), le plus grand dramaturge italien de l’époque, prix Nobel de littérature (1934), qui adhère officiellement au parti fasciste en 1924 et qui est soutenu par Mussolini, celui-ci l’utilisant comme vitrine internationale. Mais le théâtre reste surtout philosophique et critique et pas vraiment propagandiste.
Gioacchino Forzano (1883–1970), le dramaturge officiel, que nous avons déjà vu dans la partie « cinéma ». Il est très proche de Mussolini et est clairement profasciste. Ses pièces principales sont Campo di maggio (1930), sur Napoléon ; Villafranca (1931) et Cesare (1939), sur Jules César. Ces pièces glorifient les grands chefs et font écho au culte du Duce.
Sem Benelli (1877–1949), auteur, essayiste et librettiste, qui met en avant le nationalisme et l’héroïsme et qui est très populaire au début du régime. Les thèmes développés, honneur, héroïsme et grandeur italienne correspondent bien à l’idéologie fasciste. Son chef d’œuvre La cena delle beffe, écrit en 1909, sera repris par le compositeur Umberto Giordano (1867-1948) en 1924 à la Scala de Milan. On peut citer également Ugo Betti (1892-1953), auteur plus subtil, parfois critique, et Massimo Bontempelli (1878–1960), proche du régime à sa création, toléré puis marginalisé.
Musique, un outil de propagande majeur
Mussolini a dit : « La musique est un langage universel qui touche directement le cœur des Italiens ». C’est un vecteur de l’idéologie fasciste qui célèbre aussi l’identité nationale, le Duce mais aussi accompagne les cérémonies publiques et les spectacles de masse. Le fascisme va encourager la revalorisation des chants et danses populaires, souvent orchestrés pour des spectacles de masse avec, par exemple, des chants de paysans ou chants militaires adaptés pour célébrer la jeunesse et le patriotisme comme la marche “Giovinezza” qui devient l’hymne officiel du Parti national fasciste, chanté lors des rassemblements, défilés et dans les écoles. À son arrivée au pouvoir en 1922, Mussolini, très conscient de l’utilité de la culture pour promouvoir les idées du régime, emploie une stratégie populiste en facilitant l’accès du peuple à l’art, notamment à l’opéra et en développant la glorification du passé, en particulier la romanité et le Risorgimento. Le Duce fait appel à Verdi en octroyant une place prépondérante à ses œuvres car, dans la mythologie fasciste, il représente l’archétype du nouvel Italien. Il est patriote, combattant (pour acquérir sa notoriété), doté de vertus issues de la ruralité (originaire de Parme), de l’italianité et de l’humanité : c’est un homme du peuple. Et, de surcroît, c’est un génie !! Ses œuvres incarnent la représentation fasciste de la civilisation italienne, avec un esprit de redécouverte du passé. C’est aussi un puissant vecteur de propagande pour le régime et il représente un exemple-type d’une récupération à des fins idéologiques et politiques. La «generazione dell’ottanta », qui regroupe une dizaine de compositeurs parmi lesquels Luigi Dallapiccola (1904 1975), Gian Francesco Malipiero (1882-1973), Ildebrando Pizetti (1880-1968), Ottorino Respighi (1878-1936) et Alfredo Casella (1863-1947), se concentre à définir une identité nationale en redécouvrant le passé (le compositeur Monteverdi en particulier), mais aussi un développement de l’image du dictateur. « On le voit en particulier dans les opéras qui ont été produits à partir des années 1930, où il y a une forme de grand récit du dictateur, du dictateur romain : une forme d’exaltation du tyran, de la romanité toute puissante, notamment dans des œuvres de Gian Francesco Malipiero ou d’Alfredo Casella. Quand ils y évoquent l’antiquité romaine, c’est du fascisme dont il est question » note Charlotte Ginot-Slacik. Sur scène, on célèbre donc des figures antiques (en accord avec l’image du Duce), dans des décors grandioses, avec des opéras comme Giulio Cesare (Malipiero, 1936), mais aussi les héros modernes comme les aviateurs dans Volo di notte (Dallapiccola, 1940) et surtout Il deserto tantato (Casella, 1937) qui célèbrent la conquête de l’Éthiopie par les troupes italiennes. Beaucoup de ces compositeurs ont avoué leur admiration pour Mussolini, avec plus ou moins d’enthousiasme. Le cas de Pietro Mascagni (1863-1945) est différent. Célèbre compositeur de Cavalleria Rusticana, c’est une personnalité musicale de niveau mondial : chef d’orchestre, directeur d’opéra et compositeur, Mussolini en fait une des gloires de la Nation et le nomme par décret, en 1929, parmi les premiers membres de l’Académie d’Italie, créée trois ans plus tôt. En 1932, Mascagni prend sa carte du Parti National Fasciste. En 1943 il renonce à toutes ses fonctions et il s’éteint le 2 août 1945.
Conclusion.
La manipulation culturelle constitue l’un des piliers essentiels du système fasciste italien, en ce qu’elle a permis de transformer l’idéologie en expérience quotidienne et en référentiel symbolique partagé, en saturant la vie quotidienne par l’art et la culture ce qui est une expérience pionnière à l’époque. En mobilisant les arts et les rituels publics, le régime de Mussolini ne s’est pas contenté d’imposer un contrôle politique : il a cherché à façonner durablement les représentations, les identités et les comportements sociaux. Cette entreprise de normalisation culturelle visait moins l’adhésion ponctuelle que l’intériorisation progressive des valeurs fascistes, présentées comme naturelles, historiques et indiscutables amenant ainsi la construction d’une « fabrique du consentement ». Toutefois, si cette stratégie s’est révélée efficace pour stabiliser temporairement le consensus et marginaliser les oppositions, elle n’a jamais totalement supprimé les résistances et les formes de dissidence latente. La culture fascisée est ainsi demeurée un espace de tensions permanentes entre contrainte et séduction. Cette manipulation culturelle met donc en lumière les mécanismes par lesquels un régime autoritaire cherche à légitimer son pouvoir au-delà de la coercition, en investissant les sphères symboliques et émotionnelles de la société. L’analyse du cas italien rappelle que la domination politique ne repose pas uniquement sur les institutions et la force, mais aussi sur la capacité à produire du sens, des récits et des imaginaires collectifs donc un « roman national ». En ce sens, l’expérience fasciste constitue un laboratoire historique majeur pour comprendre les formes contemporaines de propagande, de contrôle informationnel et d’ingénierie culturelle dans les régimes autoritaires comme dans certaines démocraties fragilisées.
Encadré : Gabriele D’Annunzio (1863–1938) : écrivain, esthète et précurseur du fascisme
Figure centrale de la vie culturelle italienne de la fin du XIXᵉ siècle, Gabriele D’Annunzio est d’abord un écrivain reconnu, poète, romancier et dramaturge, avant de devenir un acteur politique influent. Inspiré par le symbolisme, le décadentisme et Nietzsche, il développe une esthétique fondée sur le culte de l’exception, de la beauté et de l’héroïsme. Ses romans (Il Piacere, Le Feu), sa poésie (Alcyone) et son théâtre contribuent à forger une image de l’artiste comme figure supérieure, appelée à guider la société. Cette conception élitiste et charismatique nourrit progressivement sa vision politique.
Pendant la Première Guerre mondiale, D’Annunzio met son prestige littéraire au service du nationalisme italien. Ses discours, manifestes et textes de propagande transforment la guerre en épopée esthétique. Il impose un style rhétorique exalté, fondé sur l’émotion, le symbolisme et la mise en scène.
L’épisode de Fiume, aujourd’hui Rijeka en Croatie, (1919-1920) constitue l’aboutissement de cette fusion entre littérature et politique. D’Annunzio y gouverne par le verbe, le rituel et le mythe, faisant de la cité un laboratoire de « politique poétique », où la parole et le spectacle deviennent instruments de domination. Sans être fasciste au sens strict, il fournit au régime mussolinien une grande partie de son répertoire symbolique : culte du chef, liturgie politique, esthétique martiale, mythification de la nation. Dans les années 1920, Mussolini marginalise prudemment D’Annunzio tout en récupérant son héritage symbolique. D’Annunzio incarne enfin une figure ambivalente : écrivain de génie pour les uns, esthète réactionnaire pour les autres, il fut un entrepreneur de mythes politiques, contribuant à forger le langage, les rites et l’imaginaire du régime.
Pour aller plus loin.
Bernstein S et Milza P. « Le fascisme italien (1919-1045) Points 2018.
Levy R. « Les écrivains de langue italienne sous le fascisme (1922-1945), L’Harmattan 2014.
D’Annunzio G. « Le Feu » Legare Street Press 2022.
Bovo E. “Mécanique des foules » Armand Colin 2024.
Ginot-Slacik C.et Niccolai M. » Musiques dans l’Italie fasciste », Fayard, 2019.
CAVALLERIA RUSTICANA Cossotto/Bergonzi/Allegri , Herbert von Karajan orchestra et chœurs de la Scala di Milano (2000) Deutsche Gramophon.